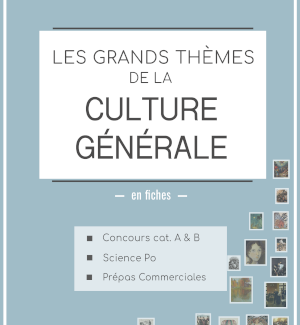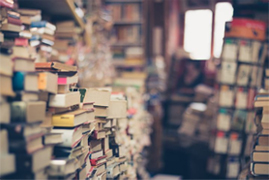aménagements conventionnels
Les parties peuvent à l’avance aménager les conséquences d’une éventuelle inexécution du contrat, et les modalités de réparation. On peut ainsi prévoir une obligation de résultat et non de moyens, ou encore prévoir que les cocontractants resteront responsables même en cas de force majeure. Diverses stipulations peuvent ainsi permettre l’aménagement du contrat.
Sanction de l'inexécution

Clauses exclusives ou limitatives de responsabilité
Les clauses de non-responsabilité permettent au débiteur de ne pas verser de dommages et intérêts en cas de litige car il n’est pas considéré responsable. Cette absence de responsabilité, inscrite dans une clause du contrat, doit donc avoir été préalablement expressément indiquée. Par exemple, les aéroports peuvent prévoir l’exonération de toute responsabilité en cas de vol des bagages.
Les clauses exonératoires de responsabilité sont valables parce qu’elles proviennent de la volonté des parties, qui ont donné leur consentement à l’ensemble du contrat et donc à ses clauses. Il existe pourtant des exceptions à ce principe. En cas de dol en effet, ou de faute lourde du débiteur, les clauses seront considérées nulles. Aussi, l’établissement d’une telle clause n’est pas totalement libre : la clause de non-responsabilité ne peut en effet porter sur l’obligation essentielle du contrat sous peine de nullité du contrat (l’obligation du débiteur n’aurait alors pas de cause). On peut également rappeler que les contrats entre professionnels et consommateurs ne peuvent comporter de clauses de non-responsabilité.
Clause pénale
La clause pénale permet de fixer par avance le montant de l’indemnité à verser en cas de préjudice, et quelque soit son importance. La convention détermine un montant forfaitaire des dommages et intérêts, qui ne peut être majorée en cas de préjudice lourd. La clause pénale permet de réparer un préjudice ou une inexécution, et intervient en conséquence après mise en demeure du débiteur. En revanche, en cas de force majeure, le débiteur ne sera pas tenu de verser l’indemnité fixée par la clause pénale.
Il revient aux parties de déterminer le montant de façon libre. Si le forfait fixé peut être inférieur à l’éventuel préjudice, on fixe généralement un montant supérieur afin d’inciter le débiteur à exécuter ses obligations.
Le juge exerce un contrôle sur la clause pénale. Après de nombreuses critiques doctrinale concernant la possibilité de révision du montant, la loi du 9 juillet 1985 intervient pour permettre au juge de « modérer au augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » (article 1152 C. civ.). La loi de1985 prévoit que le juge peut intervenir d’office. Le juge qui modifie le montant devra justifier du caractère excessif ou au contraire dérisoire de la clause pénal ; il devra s’assurer l’excès est manifeste.