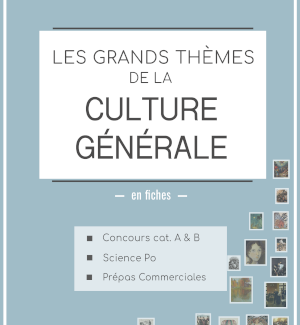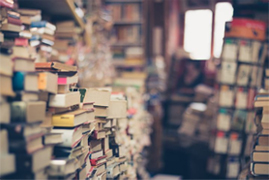Pluralisme politique
Le principe démocratique constituait l’une des principaux principes mis en avant lors de la rédaction de la Constitution en 1958. Ce principe fondamental, progressivement apparu en France, repose sur l’origine du pouvoir, mais également sur le pluralisme politique, qui repose sur l’existence de différents partis politiques, permettant ainsi aux électeurs de bénéficier d’une liberté de choix.
Le principe du pluralisme politique
En France, le pluralisme politique est réellement acquis depuis 1848, date à laquelle les tendances politiques vont réellement s’affirmer. Ainsi les socialistes ou les monarchistes acquerront un certains poids dans la vie politique.
Avant cette date, sous l’empire Napoléonien, les élections sont contrôlées, et en dehors de cette période, le suffrage censitaire crée une oligarchie dans laquelle les partis ont à peu près tous la même tendance : monarchistes à tendance libérale, conservatrice ou ultra-libérale.
Sous le second empire, on pratique la procédure du candidat officiel. Tout le monde peut se présenter, mais le candidat que soutient le pouvoir est le seul à pouvoir imprimer ses affiches sur du papier blanc ; c’est ce qu’on appelle le candidat officiel, et donc le plus facile à repérer pour les citoyens. Comme tous les candidats doivent prêter serment à l’empereur, cela limite le pluralisme.
Il faudra néanmoins attendre la 3e République pour que les partis puissent se présenter librement, pratique qui sera confirmée par la loi de 1901 permettant aux partis de se créer librement. A compter de cette date, cette pratique ne sera plus remise en cause.
De plus, le principe du pluralisme politique, base de toute démocratie, a été confirmé dans la Constitution, depuis la révision de 2008.
L’importance des partis politiques
Les partis politiques sont des associations regroupant des citoyens rassemblés autour de valeurs communes. On distingue :
- Les partis « de cadre » : partis de notables nés au 19e siècle, traditionnellement à droite et au centre.
- Les partis « de masse » : partis nés au 20e siècle qui reposent sur un grand nombre d’adhérents ayant pour objectif de transformer la société.
- Les partis d’électeurs : partis nés dans les années 1960 ayant pour objectif de rassembler le plus grand nombre.
La France est le pays où les partis politiques sont les plus faibles d’Europe ; les adhérents y sont moins nombreux. De plus, la liberté d’association a été introduite en 1901 mais les partis sont nés avant cette date et étaient des associations de fait. Certains de ces partis n’ont pas voulu entrer dans ce moule légal (cas des socialistes).
Le principal rôle des partis est de participer à l’animation de la vie politique : selon l’article 4 de la Constitution « les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage ». Ils ont ainsi pour objectif la conquête et l’exercice du pouvoir ; mais ils ont également pour fonction d’animer le débat politique et de conduire la politique nationale par le biais de leurs représentants (au gouvernement ou dans la majorité parlementaire).
On constate depuis quelques années un certain désintérêt des Français pour la politique et une certaine défiance à l’égard des partis politiques comme de leurs représentants. Cela se traduit notamment par un accroissement de l’abstention, à l’exception des élections présidentielles.
Les partis ont des droits importants : ils sont dotés de la personnalité morale (possibilité d’agir en justice), peuvent recevoir de l’argent de l’Etat depuis 1988, bénéficient d’un patrimoine immobilier, etc.