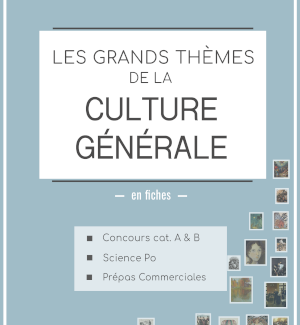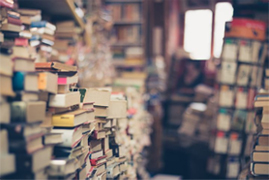Contrôle de la police administrative
Les mesures de police ont nécessairement pour effet de porter atteinte à la liberté des individus auxquels elles s'appliquent. Il est donc nécessaire q'un contrôle juridictionnel soit exercé sur cette pratique.
Le principe
Le contrôle s'ajoute au contrôle de légalité qui s'applique à toute activité administrative ; par conséquent, l'autorité de police doit respecter les règles de procédure, de compétence ou encore de légalité interne (détournement de pouvoir, violation de la loi, etc.).
Les interdictions
Certaines mesures de police administratives sont interdites. Ainsi, les autorités de police ne peuvent pas soumettre certaines libertés à une autorisation préalable ; c'est ce qui était consacré par un arrêt d'assemblée en 1951, Daudignac, visant la liberté du commerce et de l'industrie. Ce principe a ensuite été étendu à toutes les libertés essentielles.
De la même façon, les autorités de police ne peuvent prendre des mesures portant interdiction générale et absolue qui supprimerait une liberté de façon définitive.
Des mesures justifiées par la nécessité
Les mesures prises par l'autorité de police doivent être proportionnées au but à atteindre. C'est ce que consacrait le célèbre arrêt Benjamin en 1933 : l'interdiction d'une conférence était excessive, l'éventualité de troubles ne présentant pas un degré de gravité tel que d'autres mesures n'auraient pas pu être prises pour maintenir l'ordre.
Efficacité du contrôle juridictionnel
Le contrôle important du juge ne joue qu'en matière de police générale ; la police spéciale relève quant à elle du contrôle minimum.
De plus, en pratique, les décisions réglementaires de police sont seules à pouvoir être qualifiées de mesure de police interdite ; cela serait plus difficile pour les les décisions individuelles de police.
Enfin, les procédures étant souvent très longues, l'effet de mesures de police peut perdurer dans le temps alors même qu'elles peuvent porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Certaines procédures permettent donc d'écarter une mesure de police en cas d'urgence : il s'agit des procédures de référé "suspension" et de référé "liberté", qui permettent d'obtenir la suspension provisoire d'une mesure de police jusqu'à son examen au fond par le juge.