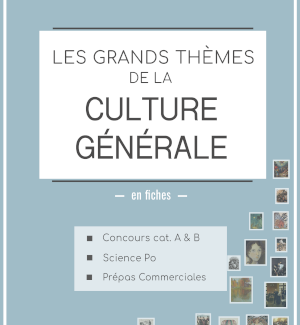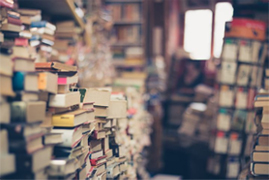notion de nullité
Lorsque l’une des conditions de formations d’un contrat n’est pas remplie, le juge peut prononcer sa nullité. La nullité peut être prononcée accompagnée d’autres sanctions ; ce peut être le cas lorsqu’une infraction pénale a été commise, ce qui entraine l’anéantissement du contrat.
Nullité du contrat

L'article 1178 et s. encadre les nullités.
Deux types de nullité
Selon les cas la nullité peut notamment être relative ou absolue :
- la nullité absolue avait vocation à protéger l'intérêt général
- la nullité relative devait protéger l'intérêt particulier
Ces deux types de nullité produisent le même effet (le contrat est censé ne jamais avoir existé). Cependant, dans le cadre de la nullité absolue, le cercle des personnes susceptibles de demander l'annulation du contrat est plus large. En effet, seule une personne dont la règle protège ses intérêts peut demander sa nullité.
La sanction de nullité se distinguent d'autres sanctions
La sanction par la nullité, consécutive à la conclusion du contrat, se distingue de la résolution, qui détruit un contrat de façon rétroactive, mais alors même qu’il n’est pas exécuté. On peut également distinguer la nullité de la caducité, qui consiste en une disparition du contrat en raison de la survenue d’un événement indépendant de la volonté des parties. La nullité ne doit également pas se confondre avec l’inopposabilité, qui sanctionne un contrat valable, mais qui ne peut produire d’effet entre les parties car il n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité requise.
- LA NULLITE sanctionne l’inobservation des conditions de formation du contrat
- L’INOPPOSABILITE sanctionne l’inobservation des conditions de publicité du contrat
- LA RESOLUTION sanctionne l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat.
Effets de la nullité
Lorsque la nullité affecte une cause déterminante du contrat, elle conduit à la nullité de l'acte. Ainsi, lorsque la cause de la nullité a cessé, une partie peut demander à l'autre, qui peut se prévaloir de la nullité, de :
- confirmer le contrat
- agir en nullité dans un délai de six mois (sous peine de forclusion)
Cette possibilité, énoncée par l'article 1183 du code, permet de réduire l'incertitude qui pèse sur les parties confronté à un cas de nullité.
La nullité est prononcée par le juge, sauf si les parties la décident d'un commun accord. Le contrat disparait alors rétroactivement, et est réputé ne jamais avoir existé. Ainsi, les prestations déjà exécutés doivent être restituées. Aussi, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi, dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle (car le contrat disparait).
L'action en nullité doit être menée dans un certain délai (prescription), sauf si elle est liée à un contrat non exécuté. La nullité est invoquée par les parties par voie d’action (dans le cadre d’un procès effectué pour la nullité elle-même) ou par voie d’exception (dans le cadre d’un procès ayant un autre objet).
Si les délais ont expiré, l'action en nullité devient impossible et l'acte nul survit. Cependant, celui qui doit exécuter cet acte nul peut utiliser l'exception de nullité (art. 1185), qui ne se prescrit pas, mais ne peut être invoquée qu'en cas d'inexécution totale du contrat (le commencement d’exécution n’est pas admis par la jurisprudence).