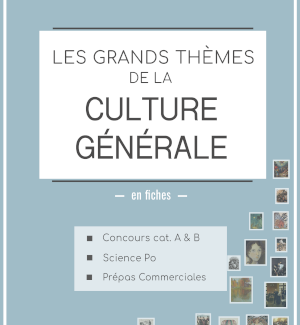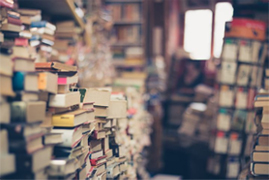Juge judiciaire
Gardien des libertés fondamentales, le juge judiciaire protège la liberté individuelle (art. 66 C) et se prononce sur l'état et la capacité des personnes ; il est également le garant de la propriété privée. Dans sa décision du 23 janvier 1987, le juge constitutionnel rappelle qu'il existe des matières "réservées par nature à l'autorité judiciaire".
Garant de la liberté individuelle
Le juge judiciaire, garant de la liberté individuelle, appliquait une conception large de la liberté individuelle, qui incluait de nombreuses autres libertés. Cette conception extensive, qui résulte d'une décision du Conseil constitutionnel de 1977 a été confirmée dans une décision du 27 juillet 1994 qui a ouvert le champ de contrôle du juge judiciaire. Progressivement, certaines libertés se détachées de la liberté individuelle pour s'autonomiser (décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2002). Désormais, la liberté individuelle se restreignant au droit de ne pas être l'objet de mesures arbitraires, le juge judiciaire n'est compétent que lorsque de telles mesures sont appliquées.
Garant de la propriété privée
Le juge judiciaire est gardien de la propriété privée depuis la loi du 8 mars 1810 sur l'expropriation, confirmée par une décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1989 par laquelle le juge constitutionnel affirme que cette compétence est un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Garant des droits fondamentaux
Le juge judiciaire doit appliquer les droits internationaux et européens ; il applique ainsi la Convention européenne des droits de l'homme en s'appuyant sur les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme.
S'il refuse le contrôle de constitutionnalité (ce qui est régulièrement affirmé par la Cour de cassation), il accepte le contrôle de conventionnalité depuis la jurisprudence IVG de 1975. Ainsi, par l'arrêt de la Cour de cassation, Cafés Jacques Vabre de 1975, le juge acceptait d'écarter une loi pour son incompatibilité au traité ou à l'accord international, ce, en application de l'article 55 de la Constitution.
Garant des libertés face à l'administration : théorie de la voie de fait
La théorie de la voie de fait constitue une exception au principe de séparation des deux ordres de juridiction : elle donne en effet compétence au juge judiciaire dans des matières qui relèvent normalement du juge administratif.
Sa mise en œuvre suppose la réunion de trois conditions :
- l'administration doit avoir procédé à l'exécution forcée d'une décision ayant porté une atteinte grave à une liberté fondamentale ou à la propriété (ex : emprise)
- l'action administrative doit être gravement illégale
- l'administration doit avoir agi en dehors de ses compétences
Lorsqu'une voie de fait est constatée, le juge judiciaire bénéficie d'une plénitude de compétence et peut donc examiner tous les actes administratifs à l'origine de la voie de fait. Il a ainsi par exemple pu estimer que le retrait du passeport d'une personne condamnée pour fraude fiscale ne constitue pas une voie de fait mais une simple irrégularité (TC, Grizivatz contre Ministre de l'Intérieur, 1987. Il appartiendra ensuite au juge judiciaire de condamner ou non la personne publique à réparer la voie de fait par le biais d'astreintes ou d'injonctions.
Cette théorie a été restreinte par l'instauration du référé-liberté (loi du 30 juin 2000).