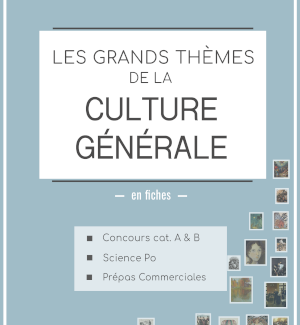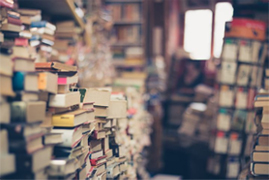Objet du paiement
L?objet du paiement
Le créancier devra recevoir la chose qui lui est due, dans les modalités préalablement établies. En effet, « Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande » (article 1243 C. civ.). La chose devra être donnée selon les termes de la convention, c'est-à-dire que la qualité et la quantité devront être respectées ; mais la meilleure qualité ne sera pas exigée, même s?il ne devra pas être offert la plus mauvaise. Si le débiteur donne, avec le consentement du créancier, un autre objet, on parle alors de dation en paiement. La réception de la chose due entraine une extinction des obligations.
La totalité de la chose devra être attribuée au créancier. En effet, « Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d?une dette, même divisible » (article 1244 C. civ.). Mais le créancier sera libre d?accepter par exemple un remboursement partiel. De même que le juge pourra l?accorder au débiteur : « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge paut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » (1244-1 C. civ.).
Pour les paiements monétaires, l?obligation repose sur des règles particulières. Le droit français s?attache au principe du nominalisme en ce sens que le débiteur ne devra la somme qu?au montant énoncé préalablement par le contrat, sans tenir compte des dévaluations de monnaie. Mais les parties pourront inclure au contrat des clauses d?indexation permettant de faire varier le montant en fonction des dépréciations monétaires, par rapport à un indice. Ce dernier sera rattaché au contrat, ou à l?activité de l?une ou l?autre des parties. Dans le premier cas, s?il s?agit de l?achat d?un immeuble, l?indice variera selon le cout de la construction.