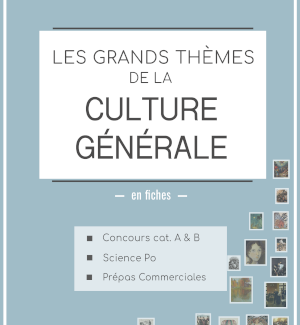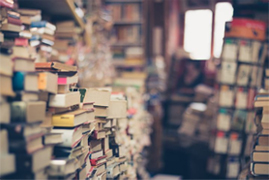Droits de l'homme
La France, « pays des droits de l’homme », a comme beaucoup d’autres pays multiplié les actions de lutte pour les droits de l’homme. Les grandes démocraties prônent ces droits depuis très longtemps ; il est donc intéressant de revenir sur cette progression.
Du droit naturel au droit positif
Aristote considérait que le droit naturel était inscrit dans la nature même de l’homme, vivant dans l’ordre naturel, qu’il lui suffisait de le découvrir. Il existe donc une loi naturelle qui permet à l’homme de vivre dans la cité ; les hommes sont des « animaux politiques », qui naturellement sont faits pour vivre dans la Cité. Si cette conception sera reprise par Saint Thomas d’Aquin bien plus tard, il n’en est pas moins qu’à ce droit naturel s’opposera le droit positif.
Dès l’Antiquité, on montre la dualité qu’il existe entre le droit naturel et le droit positif. Dans Antigone, Sophocle montre la « mort misérable » qui attend Polynice si Antigone passe outre la sentence prononcée par le roi de Thèbes. Antigone en appelle, en souhaitant enfreindre l’interdiction du roi, « aux lois non écrites, inébranlables, des dieux ! ».
Le droit positif des Modernes va néanmoins progressivement s’affirmer et se substituer au droit naturel des Anciens. Le droit positif se fonde sur les lois établies par un Etat, que le peuple doit respecter. Les Modernes considèrent que le droit naturel a besoin du droit positif pour exister ; il y a bien un droit de nature et une loi de nature, qui donne des obligations aux hommes, mais ce droit et ces lois s’exercent dans un état de guerre perpétuel. L’état naturel des hommes selon Hobbes oblige donc les hommes à passer par un contrat social au profit d’un souverain pour éviter l’état de guerre universel. Le droit positif est alors nécessaire pour sauver les hommes et incarne la loi naturelle. L’homme doit disposer, selon Grotius, Hobbes et Pufendorf, d’un droit qui lui est attaché car il est libre de sa conscience et autonome. L’homme se détermine seul, et ne doit plus découvrir un ordre naturel qui le dépasse.
C’est donc peu à peu que divers droits vont être revendiqués. On va progressivement parler de liberté de conscience, de droit de propriété (Locke)… Avoir ces droits permet à l’homme d’avoir du pouvoir face à l’autorité ; il peut même contester l’ordre établi. Autrefois, on ne pouvait bousculer l’ordre établi dans la mesure où il était naturel.
Affirmer des droits
Si certain ont pu réclamer l’égalité des hommes (les Pères de l’église notamment) pendant des siècles, c’est avec la Réforme qu’on affirme l’égalité de tous les hommes devant Dieu. On va également reconnaitre l’autonomie de l’individu, pour enfin reconnaitre que l’homme a des droits imprescriptibles, tout comme il a des devoirs (Grotius).
L’Angleterre va aller dans ce sens en votant l’Habeas corpus en 1679. Quelques philosophes vont ainsi reconnaitre des droits à l’homme. Locke, libéral, considère que l’homme bénéficie de droits naturels inaliénables, qu’il peut opposer au pouvoir en place. Il est donc lié au pouvoir par un contrat, qui peut à tout moment être révoqué. Le pouvoir étatique se voit donc limité par des droits inhérents à l’homme.
Progressivement, ces conceptions vont s’étendre en France, qui va les adopter et les diffuser, notamment par le biais de la franc-maçonnerie. C’est ainsi que les droits de l’homme vont s’affirmer.
Mais si des droits peuvent être affirmés, il faut qu’ils puissent être écrits pour qu’ils aient une réelle force. Des déclarations de droit sont nécessaires ; solennelles, ces déclarations doivent rendre les droits effectifs et universels. C’est ainsi qu’est établie la Déclaration d’indépendance américaine (4 juillet 1776), la Déclaration des droit de l’homme et du citoyen de 1789, et plus tard, la Déclaration universelle de 1948.
Quels droits ?
Les diverses déclarations contiennent différents droits inhérent à l’homme. Les premiers textes évoquaient les grandes libertés civiles et politiques (droits dits de première génération, les « droits de ») : liberté de propriété, liberté de conscience, liberté d’expression… Ces droits sont individualistes, fondés sur la personne même qui en bénéficie, sans prise en compte de son environnement social ; ce sont des libertés individuelles, qui permettent néanmoins au citoyen de participer à la vie publique. Ce n’est donc que par la suite qu’on est aux « droit à » un travail, à la culture…. Ces droits économiques et sociaux vont ainsi prendre l’aspect collectif de la vie ; ils ont été établis plus tardivement, au 19e siècle, alors que l’Etat providence commençait à apparaitre. On est ainsi passé des droits-libertés aux droits-créances (la société nous doit quelques chose car on a par exemple le droit de faire la grève, ou encore le droit d’avoir une éducation). Enfin, des droits plus récents sont apparus ; ce sont les droits dits de 3e génération, qui prennent l’homme dans son environnement actuel (protection de la vie privée, protection contre la pollution…).
Critiquer les droits
De nombreuses critiques des droits de l’homme sont rapidement venues apporter des limites à l’enthousiasme de leur édiction. Nous allons étudier les principales :
- Les droits de l’homme sont une manifestation de la puissance
occidentale.
Les droits de l’homme tels qu’on les connait sont des émanations des grandes démocraties, qui en étendent les principes un peu partout dans le monde. on a donc pu reprocher à ces droits de ne pas être universels. Ces droits sont en effet ancrés dans une conception politique particulière ; certaines civilisations ne considèrent en effet pas l’homme seul, mais en communauté. L’individu n’est alors pas le centre de tout.
Certains pays arabes, ou même la Chine dénoncent ainsi l’impérialisme occidental en la matière. En revanche, il convient de rappeler que les évènements de la place Tiananmen en 1989 prônaient justement les droits de l’homme.
Enfin, certaines minorités revendiquent des droits qui leurs seraient propres. C’est par exemple le cas des femmes, ou des enfants.
On comprend alors que les droits de l’homme ont du mal à être universels.
- Les droits de l’homme sont abstraits
Ces droits ne sont pas inscrits dans le temps, et dans la réalité selon plusieurs philosophes. Edmond Burke va rapidement considérer que les droits de l’homme déclarés en 1789 sont totalement abstraits et situé en dehors de toute temporalité ; ces droits n’ont pour seul but que de mettre en place une masse populaire incontrôlable. De même, Hegel montre que cette vision va à l’encontre de la progression de la société dans le temps, qu’elle en est en dehors.
Joseph de Maistre pense également que les droits de l’homme sont abstraits, et oublient la finalité humaine.
- Les droits de l’homme ne font qu’exacerber l’égoïsme de l’homme
Ces droits attribuent à l’homme la faculté d’avoir sa propre liberté. En ce sens, Marx considère que les révolutionnaires français n’ont fait que proclamer « solennellement le droit de l’homme égoïste ».