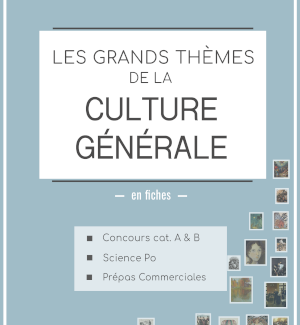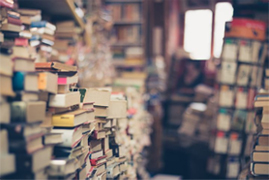La question environnementale
Présente depuis de nombreuses années sur la scène politique internationale, la question environnementale s’est à nouveau invitée dans le débat public. Et pour cause, de nombreux rapports alarmistes montrent que la Terre se réchauffe à une vitesse considérable, que les évènements climatiques extrêmes vont aller croissant et que la température du globe va augmenter.
Un état des lieux alarmant
Les épisodes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents dans le monde. Les scientifiques prévoient la répétition d’évènements intenses, à l’image de l’hiver 2013-2014, pour les prochaines années.
Le réchauffement climatique a pour conséquence d’intensifier les extrêmes météorologiques (il pleuvra davantage dans les zone où il pleut déjà beaucoup, et il pleuvra moins dans les zones arides), ce qui expliquerait la sècheresse exceptionnelle qui a sévi en Californie, les intenses chutes de neige à Tokyo, mais aussi l’augmentation des tempêtes et inondations au Royaume-Uni. De plus, l’élévation des mers pourrait accentuer le phénomène, notamment dans les régions comme la Bretagne.
Cependant, de nombreux scientifiques restent prudents et refusent d’établir un lien direct entre ces phénomènes climatiques et le changement climatique.
Une pollution mondiale croissante
Pour l’OMS, la mauvaise qualité de l’air est « désormais le principal risque environnemental pour la santé dans la monde ». En 2013, le Contre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l’OMS, classait la pollution atmosphérique dans la catégorie « cancérigène certain ».
En 2012, la pollution de l’air a en effet été responsable d’un décès sur huit au niveau mondial (7 millions de décès). C’est presque le double de la fin des années 2000.
La pollution de l’air intérieur serait responsable de 4,3 millions de décès par an, la pollution de l’air extérieur, de 3,7 millions de personnes par an. La pollution intérieure est importante dans les pays en développement, là où les appareils de chauffage ou de cuisson ont un foyer ouvert, émettant différents polluants. Elle est notamment responsable d’AVC, de bronchopneumopathie chronique obstructive ou encore d’infections aigues des voies respiratoires chez l’enfant.
En Europe, de nombreux pays ont connu de graves épisodes de pollution atmosphérique ces dernières années, et notamment en 2014.
L’Agence européenne de l’environnement (EEA) rapportait fin mars qu’onze Etats (France, Autriche, Belgique…) avaient franchi le seuil à ne pas dépasser en 2012, pour au moins un type de polluant. En Europe occidentale, la pollution extérieure est en effet responsable de 280 000 morts par an, un chiffre bien supérieur à l’Amérique du Nord (94 000 décès par an).
En Chine, la pollution atmosphérique atteint des taux considérables. Dans certaines régions urbaines, les habitants sont désormais incapables de voir le ciel. La pollution des sols est également préoccupante : près de 17 % des sols du pays seraient en effet pollués par les activités minières, agricoles et industrielles.
Les autorités chinoises imposent de rares mesures peu efficaces : pulvérisation d’eau le long des routes pour maintenir les poussières de charbon au sol, mise en place d’une circulation routière alternée, etc. Mais les industriels du charbon dénoncent le coût des installations destinées à limiter la pollution (filtres à sulfates et nitrates). De son côté, le gouvernement limite les mesures pour éviter de menacer l’emploi local et les finances.
La multiplication d’études alarmistes
Sur le changement climatique
Le GIEC a rendu en avril 2014 le dernier volet de son 5e rapport, dans lequel il rappelle que les Etats doivent agir rapidement pour limiter la hausse moyenne des températures mondiales à 2 °C. Sept ans après le précédent rapport, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux record et leur croissance est plus rapide. Pour le GIEC, le développement des énergies renouvelable n’a pas pu limiter les effets de l’utilisation accrue du charbon.
En Allemagne, la limitation du nucléaire a renforcé l’utilisation du charbon.
Le cinquième rapport du GIEC confirmait le diagnostic annoncé dès les années 1990 : les petites îles du Pacifique devront faire face à des risques de submersion importante voire totale. Et en effet, la hausse annuelle y atteint 1,2 cm par endroit, c’est-à-dire quatre fois plus que la moyenne mondiale. Ces changements font émerger un débat sur la création d’un mécanisme de « pertes à dommages » destiné à compenser les conséquences d’une élévation des températures ; la question de ce mécanisme, qui fait reposer la responsabilité d’une réparation aux pays industrialisés, pourrait se trouver au cœur de l’accord mondial sur le climat qui pourrait être signé en décembre 2015 à Paris.
La question du réchauffement climatique inquiète de plus en plus. Selon un sondage IPSOS, 75 % des Français (contre 66 % en 2010) considèrent que les conséquences du réchauffement se font sentir en France. Mais les conséquences se ressentent surtout à des endroits précis de la planète, qui connaissent des évènements climatiques extrêmes. Et les épisodes polaires et caniculaires risquent de s’accroître.
Sur le déclin des pollinisateurs
En juin 2014, une vaste étude scientifique révélait le rôle des pesticides dans l’érosion de la biodiversité. Ont ainsi été mis en évidence le rôle de cette contamination dans le déclin des abeilles et dans celui des bourdons. L’ampleur de ce déclin se mesure aux niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire (oiseaux). Mais il pourrait également avoir de lourdes conséquences sur l(agriculture et la production alimentaire.
Nombreux sont ceux qui avaient déjà souligné le déclin accéléré de toutes les espèces d’insectes depuis les années 1990. Les pouvoirs publics prennent aujourd’hui la mesure du problème. Barack Obama a ainsi lancé en juin 2014 une « stratégie fédérale pour la santé des abeilles et autres pollinisateurs ».
Quelles mesures politiques ?
Depuis les premières études sur le réchauffement climatique, de nombreuses mesures politiques sont venues en limiter les effets.
A la fin des années 1990, le rapport Brundtland avançait la notion de développement durable, qui devait permettre une meilleure prise en compte des questions environnementales sur le moyen-long-terme sans remis en question du développement économique.
Puis plusieurs sommets internationaux ont ensuite progressivement fait du changement climatique un véritable enjeu. Néanmoins, le protocole de Kyoto en 1997 et les différents sommets internationaux ont longtemps eu peu d’effets concrets. Le sommet de Copenhague n’était pas parvenu à l’établissement d’un traité contraignant à l’échelle mondiale sur les émissions de CO2.</>
Néanmoins, la mise en place de ces mesures s’est heurtée à la réticence de nombreux Etats concernés.
L’essentiel des émissions de C02 est le fait des régions du Nord. Par conséquent, l’environnement n’est pas menacé par le développement économique des pays émergents, mais plutôt par le surdéveloppement des pays développés.
De plus, les conséquences du dérèglement climatique concernent surtout les pays peu développés économiquement.
La force des acteurs privés
L’opinion publique a montré sa mobilisation croissante pour lutter contre le dérèglement climatique. De nombreuses associations réclament la création ou le renforcement de certaines mesures, sensibilisant ainsi une partie de la population mondiale.
En septembre 2014, une marche mondiale pour le climat rassemblait des milliers de personnes dans les grandes villes du monde.
Parallèlement à la mobilisation de la « société civile », certaines multinationales se sentant de plus en plus menacées par les impacts du dérèglement climatique appellent à lutter contre le réchauffement.
Ainsi, Coca-Cola fait partie des entreprises régulièrement menacées par les évènements climatiques en raison de ses approvisionnements en eau ou en canne à sucre.
Plusieurs personnalités du monde des affaires (ancien maire de New York, ancien président de Goldamn Sachs…) ont financé des recherches sur l’impact de l’évolution climatique sur les entreprises. Ces trois personnalités ont publié un rapport fin juin 2014 intitulé « Risky Business », et qui rend compte des incidences économiques et financières désastreuses du réchauffement climatique. La hausse des températures et la montée des eaux pourrait en effet faire disparaitre un patrimoine économique et financier considérable, mais aussi réduire la productivité des domaines d’activité de plein air (agriculture, construction…).
La force des acteurs publics
Après avoir subi des évènements météorologiques extrêmes, les Etats-Unis ont lancé un plan climat pour l’agriculture. Il s’agira de créer sept « pôles climat » pour aider les agriculteurs à s’adapter aux nouvelles conditions climatiques. Ces mesures doivent permettre de mieux anticiper les phénomènes naturels qui s’amplifient avec le réchauffement climatique.
Début 2014, Barack Obama a annoncé la création d’un fonds climat destiné à aider les communautés locales à se préparer aux conséquences engendrées par ces conditions extrêmes. Les pertes globales pour les Etats-Unis ont en effet été estimées à 1150 milliards de dollars pour la période 1980-2010.
Pour se protéger de la montée des eaux, New-York explore différentes pistes. De la même façon, le président de Kiribati, archipel du Pacifique situé en première ligne face au changement climatique, a décidé d’acheter une île à 2000 km de là pour y évacuer ses habitants en cas de nécessité.
En 2014, le GIEC a préconisé de concentrer les actions politiques sur les villes, qui représentent le quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais les progrès devront avoir lieu dans bien d’autres domaines (transport, habitat, agriculture…). Ces mutations devront s’accompagner d’un changement des modes de vie.
Le chemin reste encore long pour aboutir au premier accord mondial de lutte contre le réchauffement que se donne pour ambition la conférence des Nations unies sur le climat qui réunira en 2015 tous les grands émetteurs de gaz à effet de serre.
La Conférence Paris Climat 2015 permet à la France de mettre en avant son engagement dans la lutte contre le dérèglement climatique, démontrant son exemplarité en matière environnementale.
Cependant, les principaux pays pollueurs de la planète ont montré peu d’intérêt à l’égard du sommet, voire refusé d’y participer, à l’image de la Chine, de la Russie ou du Japon.
En attendant, en septembre 2014, un sommet extraordinaire de l’ONU rappelait au pays concernés l’urgence de la situation en vue de la Conférence de Paris. Mais en décembre, le sommet sur le climat, à Lima, a cependant peu mobilisé.
La France a promis de verser 1 milliards de dollars pour aider les pays en développement à s’adapter au changement climatique.
L’Union européenne est parvenue à un accord en octobre 2014. Un mois plus tard, la Chine et les Etats-Unis ont trouvé un accord pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les deux géants représentant 45 % du total des émissions de CO2 à eux seuls.
Quels effets ?
L’élimination des gaz nocifs a limité le réchauffement climatique et résorbé en partie le trou de la couche d’ozone, et les scientifiques espèrent sa résorption totale avant 2050. Cela devrait éviter environ deux millions de cancers d’ici-là. Ainsi, le protocole de Montréal est l’un des traités environnementaux qui a eu le plus de succès.
Cependant, nombre de scientifiques montrent que les efforts restent insuffisants pour limiter la hausse de la température mondiale au-delà de 2 °C (objectif fixé par la communauté internationale).
Pour aller plus loin : la criminalité environnementale
Les crimes environnementaux représentent plus de 156 milliards d’euros par an, et ces trafics financeraient les groupes armés et le terrorisme.